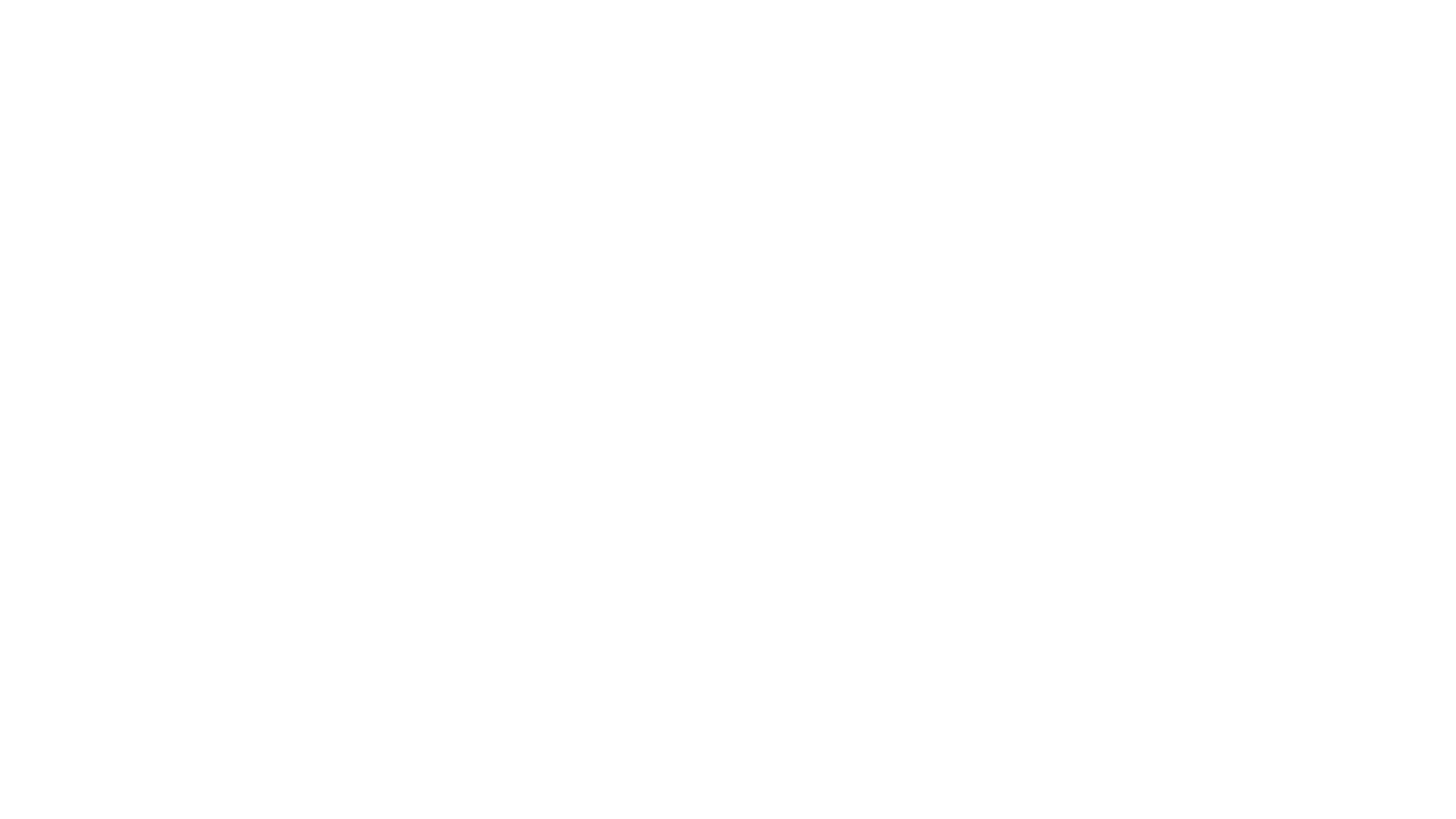Une Conférence publique a été organisée le 15 février 2013 à Abidjan en Côte d’Ivoire, en vue de rendre publics les premiers résultats du projet de recherche de la Coalition pour la Protection du Patrimoine Génétique Africain (COPAGEN) sur les acquisitions massives de terres en Afrique de l’Ouest, en collaboration avec le CRDI, Interpares et le Redtac de l’Université de Montréal. La conférence publique visait à informer un public élargi sur l‘ampleur, les acteurs et les mécanismes du phénomène dans huit pays de l’espace UEMOA et la Guinée.

- Le SG d’Inades-Formation prononçant le discours d’ouverture
La conférence publique organisée le 15 février 2013 par la COPAGEN sur les acquisitions massives de terres en Afrique de l’Ouest a vu la participation de plusieurs membres de coopératives locales et faitières de filières agricoles, d’Organisations de la Société Civile, des membres du corps diplomatique notamment SE Mme l’ambassadeur du Canada, Mme la Représentante Résidente de la FAO, et pour la partie gouvernementale des représentants du Conseil Economique et Social, du Ministère de l’Agriculture, du Ministère des Eaux et Forêts de la République de Côte d’Ivoire et du Conseil Café-Cacao rattaché au Ministère de l’Agriculture. Tous ont contribué à la richesse de ce débat sur les acquisitions massives de terres, un thème au cœur de l’actualité ; puisque à travers celui-ci, c’est toute la question du développement durable et de la réduction de la pauvreté en Afrique qui est posée.
Même si certains diront que le phénomène d’acquisitions massives des terres date de la période coloniale dans la plupart des pays africains, il s’est amplifié à une vitesse étonnante, ces dernières années.

- Mme Loredana Marchetti , représentante CRDI
Lancé en juin 2012, le projet d’étude de la COPAGEN montre clairement que les acquisitions massives de terres en Afrique de l’Ouest gagnent du terrain. A l’heure actuelle, les études d’impacts n’ont pas encore été menées, mais on remarque déjà que des pays pourtant en proie à l’insécurité alimentaire sont des cibles pour des investissements pour la production d’agro-carburants (essence produite à base de denrées alimentaires), c’est le cas pour la Guinée.
Les neuf pays [1] de l’Afrique de l’Ouest concernés par l’étude totalisent à eux seuls, une superficie de terres acquises supérieure à trois millions d’hectares [2] . Ce chiffre risque cependant de connaitre une hausse car de récents cas ont été identifiés après la clôture de cette première phase de la recherche.
Au Bénin, ce sont les acquisitions à grande échelle de onze mille hectares qui se réalisent sans concertation préalable avec les communautés rurales, en violation flagrante de leur droit de participer aux prises de décisions publiques, tel qu’énoncé dans certains instruments juridiques internationaux.
En Guinée Bissau, c’est une île entière, lieu de refuge d’une biodiversité exceptionnelle, lieu de culte et lieu d’alimentation qui vient d’être cédée à investisseur étranger. Au-delà des risques de perte de la biodiversité, ce sont les repères culturels des populations riveraines qui s’érodent.
En Côte d’Ivoire, la majorité des journaux publics et indépendants ont annoncé la signature d’un contrat portant sur cent mille hectares pour une firme multinationale, en février 2013.

- S.E Mme Chantal de Varennes, Ambassadeur du Canada en Côte d’Ivoire
Madame l’Ambassadeur du Canada en Côte d’Ivoire, S.E Mme Chantal de Varennes, dans son mot introductif à la conférence, a rappelé que la Côte d’Ivoire est l’un des Pays pilote de l’initiative du G8 sur la sécurité alimentaire et la nutrition et qu’il est important que la recherche scientifique apporte des résultats afin d’aider le pays dans sa marche vers l’émergence.

- Les conférenciers de la droite vers la gauche :
Dr. Assétou Samaké, épse MIGAN, Université de Bamako, Mali
Dr. Mamadou Goita, Directeur IRPAD Afrique Mali
Dr. René Segbenou, Consultant Indépendant, Benin
Le Dr. Mamadou Goita, Directeur Exécutif de l’IRPAD/Afrique, a présenté une synthèse des études, avec les premiers résultats sur les mécanismes, l’ampleur et les acteurs impliqués. La phase exploratoire indique bien que les terres acquises l’ont été sous les deux régimes qui se côtoient dans tous les pays concernés : le régime coutumier caractérisé par des droits légitimes (et légaux dans certains pays) et le régime du droit moderne ou droits légaux.
Les usages varient selon les types de spéculation mais se regroupent autour de :
- La production végétale (alimentation humaine ou animale pour exportation, agro carburant etc…)
- La production minière industrielle ;
- Le tourisme de différentes natures
La tendance des usages varie d’un pays à un autre, et au sein du même pays, d’une région à une autre.
La littérature abondante indique bien le rôle des acteurs internationaux dans les acquisitions des terres. Notre recherche à ce stade exploratoire montre bien que dans les différents pays, beaucoup d’acteurs nationaux sont aussi impliqués dans les acquisitions des terres avec les mêmes usages et à travers les mêmes modes de cession. Les différents acteurs qui interviennent dans les transactions sont entre autres :
- Vendeurs/ Cedeurs notamment le pouvoir coutumier, les collectivités territoriales (conseils), des personnes physique propriétaires terriens….
- Acquéreurs/acheteurs : des personnes physiques notamment les élites politiques, économiques, religieuses, sociales locales et nationales, les entreprises nationales et internationales, les états tiers, les Organisations intergouvernementales….
- Intermédiaires : État, les personnes influentes (notamment élites politiques, économiques, religieuses et sociales), les institutions de développement, la diaspora de certains pays…
Les motivations des acteurs pour justifier les cessions des terres sont multiples :
* Concernant les populations locales
- Précarité des moyens
- Peur de perdre les terres « si on ne les vend pas »
- Eloignement des zones de production des zones d’habitat
- Création d’emplois surtout pour les jeunes
- Moyens d’accès à des infrastructures sociales de base dans lesquelles l’Etat qui doit investir ne le fait pas
- Intérêts publics à travers la dépossession
- Terres non « fertiles »
- Alliances familiales
- Réponses aux pressions des élus locaux ou nationaux
- Besoins des investissements étrangers
* Concernant les acquéreurs/acheteurs
- Accéder à la terre qui a de la valeur marchande
- Augmenter la production et les revenus des ménages ruraux ;
- Contribuer au développement du pays par la création de la richesse
Les perceptions des acteurs sont aussi diverses et ne renvoient pas à une seule réalité, mais il a été possible de répertorier les différents arguments selon les visions des différentes parties impliquées dans les transactions.
* DES VENDEURS/OCTROYEURS
- Une manière de résoudre temporairement les problèmes de l’aménagement des terres agricoles pour les exploitations familiales ;
- « Nous gagnons, ils gagnent » (Gagnant/gagnant mis en avant par les investisseurs)
- Faible assistance de l’Etat aux producteurs agricoles notamment
- DES ACQUEREURS/ACHETEURS
- Permet de contribuer à la sécurité alimentaire ;
- Permet d’augmenter les revenus des producteurs ;
- Permet de valoriser les ressources naturelles et minières ;
- Diversifier les activités agricoles pour mieux contribuer au développement.
* DES INTERMÉDIAIRES
- Souci d’assister les communautés locales pour avoir des partenaires qui investissent pour le développement des localités ;
- Améliorer le statut des localités ;
- Faire des affaires porteuses (intérêts personnels)
* DES COMMUNAUTES LOCALES
- « Tout appui extérieur peut aider au développement de nos localités et améliorer les conditions de vie »
- Aspiration au mieux-être ;
- Méconnaissance des textes réglementaires sur le foncier
- « Nous sommes pauvres et nous n’avons pas de choix »
- « Si tu ne le fais pas les autres vont le faire ».
Cette première phase exploratoire de la recherche a permis de mieux cerner le phénomène d’acquisition massive de terres à un niveau régional. De nombreux textes ont été recensés sur le phénomène dans le Sud, mais aussi en Afrique Sub-saharienne. L’étude confirme aussi que la juxtaposition des droits moderne et coutumier représente un enjeu considérable pour la gestion et l’administration du foncier rural, en Afrique.

- M. le Représentant du Conseil Économique et Social participant au débat
A partir de l’étude inventaire sur les neufs pays, trois pays ont été sélectionnés pour une étude d’impacts, ce sont : la Guinée Conakry, la Guinée-Bissau et la Côte d’Ivoire. Dans ces pays, les cas d’acquisition à grande échelle sont très récents et il reste encore à établir une analyse des impacts social, environnemental et économique. Ces études suivront un principe méthodologique similaire à la recherche-participative, dans laquelle la recherche se fait en collaboration avec les communautés paysannes concernées par les cas d’acquisitions, dans ces pays.
Vanessa Shaka