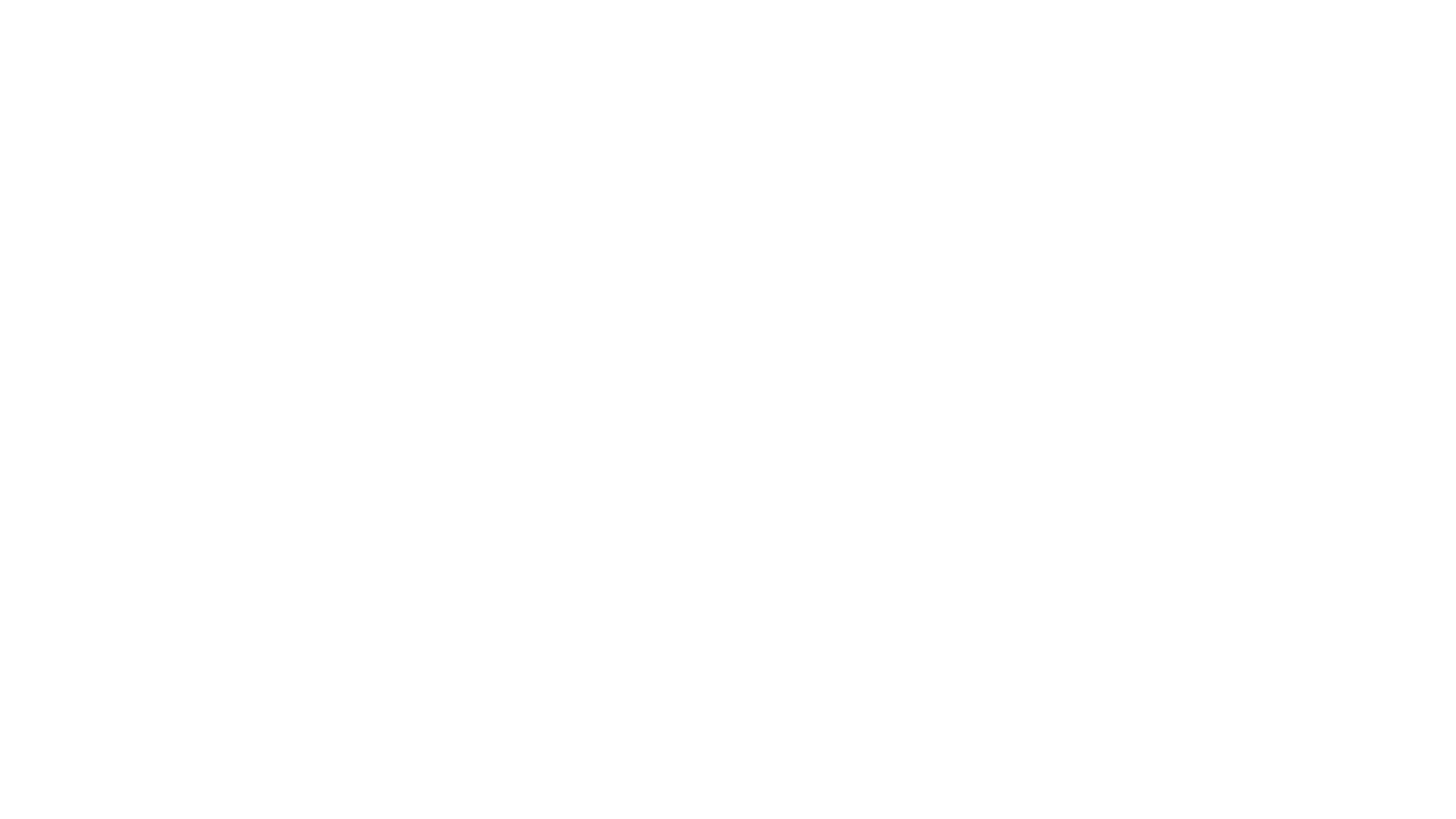En vue de la promotion des systèmes alimentaires basés sur l’agriculture familiale, le mercredi 11 avril 2018, s’est tenu au Secrétariat général d’Inades-Formation, un forum d’échanges sur les savoirs et expériences en matière de valorisation de mets à base de vivres de souveraineté et exploration d’opportunités d’entreprenariat des femmes restauratrices en Côte d’Ivoire.
Ce forum, organisé par le Secrétariat général en partenariat avec Inades-Formation Côte d’Ivoire dans le cadre du programme de valorisation des vivres de souveraineté, a vu la participation d’une trentaine de femmes restauratrices, transformatrices de vivres de souveraineté tels que le mil, le sorgho, le haricot/niébé et le poulet local. Ces femmes sont venues des communes d’Abidjan et d’autres villes du pays notamment le Nord et le centre de la Côte d’Ivoire où ces vivres sont le plus consommés.

Pour rappel, les « vivres de souveraineté » sont, du point de vue conceptuel[1], des cultures vivrières et produits d’élevage et/ou produits de la cueillette traditionnellement dominantes dans l’alimentation des populations locales des pays africains au Sud du Sahara mais qui de nos jours, sont en perte de vitesse au niveau de la production et de moins en moins importante, dans le panier alimentaire des ménages. Les causes de cette perte d’importance sont diverses :
- Abandon progressif, par les producteurs, pour des raisons de pénibilité du travail, surtout au niveau du conditionnement ;
- Changements au niveau des habitudes de consommation pour raison de substitution par d’autres produits importés ou issus des semences hybrides ;
- Baisse du soutien au développement du secteur agricole familial et des échanges alimentaires entre villes et campagnes, l’accent mis sur des politiques de promotion de la monoculture d’exportation au détriment des cultures traditionnelles.
Or, ces cultures, véritables vivres de souveraineté, ont des grandes vertus – valeurs nutritives mondialement reconnues, valeurs thérapeutiques, valeurs culturelles / traditionnelles (utilisées spécialement pour des rites traditionnels ou cérémonies traditionnelles, comme les mariages, baptêmes, funérailles, etc.). C’est enfin des cultures vivrières de résilience (sols pauvres, changement climatique, etc.), les exploitants agricoles familiaux, surtout les femmes, sont les dépositaires d’un vaste savoir et savoir-faire accumulé autour de ces produits en matière des pratiques culturales enrichies transmises de génération en génération, de recettes pour cuisiner les « mets du terroir » et de la préservation de l’agro-biodiversité.
En effet, le concept de « vivres de souveraineté » découle de ces caractéristiques de résilience, de savoir et savoir-faire accumulé sur les semences, les techniques culturales et des recettes pour cuisiner. Ainsi, repositionner les « vivres de souveraineté » au cœur des systèmes alimentaires des pays africains permettra entre autres :
- De consolider et amplifier le patrimoine intellectuel et culturel des populations locales (savoir, savoir-faire et savoir vivre locaux) en matière de pratiques culturales et de recettes pour cuisiner les « mets du terroir » enrichies et transmises de génération en génération, ce qui constitue d’importants leviers de souveraineté alimentaire ;
- De retisser les liens décisifs entre villes et campagnes, soutenir l’émergence d’une économie sociale et solidaire (solidarité ville-campagne), comme moteur d’amélioration du système de desserte des marchés locaux et urbains et à tous les acteurs intervenant dans la production, la transformation et la distribution de vivres obtenues dignement du fruit de leur labeur ;
- De stimuler la prise de conscience sur le rôle stratégique des vivres de souveraineté dans les systèmes alimentaires locaux et nationaux et d’attirer l’attention des décideurs et du grand public sur les menaces de disparition de produits alimentaires locaux et les opportunités présentes.

Le forum a été articulé autour des objectifs suivants :
- Mettre en relation les femmes restauratrices de vivres de souveraineté et analyser ensemble les enjeux et défis de la valorisation des services de restauration à base de vivres de souveraineté dans la perspective du « concept de Restaurants de Proximité » ;
- Collecter les pratiques et savoirs associés aux mets de souveraineté ;
- Stimuler les initiatives de mise en réseau de femmes restauratrices de vivres de souveraineté à Abidjan.
Les participants ont ainsi échangé sur l’importance de la valorisation des services de restauration à base de vivres de souveraineté.
Un accent a été mis le positionnement du principe de la souveraineté alimentaire, la promotion de mets reconnus pour leurs valeurs nutritives, thérapeutiques, culturelles et les opportunités offertes en matière d’entreprenariat et autonomisation de femmes.
Les participantes, qui, déjà, connaissent les valeurs de ces vivres de souveraineté, ont affirmé leur adhésion à cette vision et remercié Inades-Formation pour l’initiative de promouvoir ces produits agricoles ancestraux.

Les Vivres de souveraineté, des produits appréciés par la population mais insuffisamment mis en valeurs.
Les femmes restauratrices participant au forum ont reconnu l’intérêt que la population porte aux mets issus des vivres de souveraineté et du marché potentiel qu’ils constituent.
Selon elles, toutes les couches de la population aiment à les consommer . Toutefois, pour regagner une place de choix dans les habitudes alimentaires des populations, les produits devraient être mis en valeurs à travers une meilleure présentation des mets, des menus variés, la modernisation des étals de vente, une communication soutenue, etc. Toute chose qui demande aux femmes de se montrer créatives, novatrices et déterminées.
Elles ont partagé leurs expériences quant aux difficultés rencontrées dans l’exécution de leurs activités de restauration à base des vivres de souveraineté sur le plan aspect organisationnel, financier, matériel, disponibilité des produits, prix des produits, qualité des produits, clientèle. Elles ont relevé leurs besoins pour consolider et promouvoir leurs activités.
Ainsi, les questions d’hygiène, de présentation, de traitement des produits ont été relevées. Ce fut l’occasion pour elles de se donner des conseils les unes aux autres pour l’amélioration de leur activité commerciale.
Elles ont ainsi exprimé le besoin d’un réseautage entre les restauratrices afin de garantir la disponibilité et la qualité des vivres de souveraineté, échanger des informations d’ordre opérationnel et promouvoir la solidarité autour de leur métier. Elles ont par ailleurs identifié diverses actions de communication pour la promotion des vivres de souveraineté.
Ce fut également l’occasion d’entretenir les participantes sur les exigences en matière de gestion des commandes de restauration des vivres de souveraineté pour leur permettre d’être davantage compétitives dans la conquête de nouveaux marchés.

De nouveaux mets identifiés
Ce forum avec les femmes a permis d’identifier 16 nouveaux mets locaux, souvent créés ou inventés par les restauratrices elles-mêmes en s’inspirant des menus modernes faits à partir d’autres céréales, légumineuses ou autres.
Ainsi, les participantes ont pu se rendre compte de la diversité des propositions et de la possibilité infinies de créer de nouveaux mets. Une possibilité qu’elles avaient déjà entrevue à travers les échantillons de mets et boissons à base de vivres de souveraineté apportées par les unes et les autres.



Les femmes engagées pour la poursuite des échanges et des apprentissages collectifs
Le forum s’est clôturé sur fond d’un enthousiasme de participantes et sur l’engagement à approfondir les questions relatives aux aspects organisationnels, à la qualité des services de restauration et des mets offerts, à la communication et à la mise en réseau.