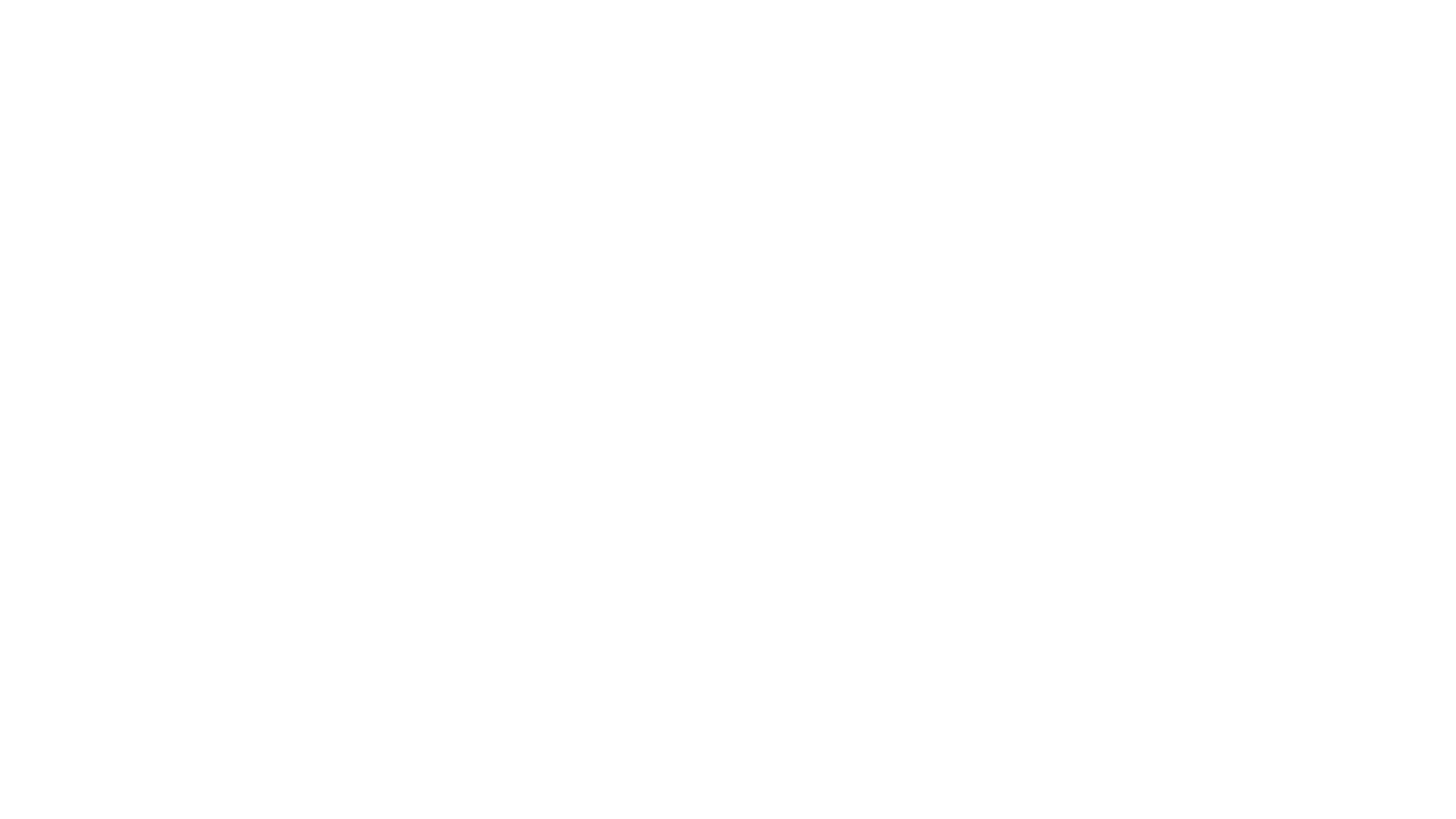L’enjeu est de soutenir la création des conditions nécessaires pour une plus grande productivité de l’agriculture familiale et une rémunération juste et équitable du travail des paysans.
Quelques éléments liés au contexte de l’agriculture familiale en Afrique
L’agriculture est l’un des piliers les plus importants des économies africaines. De manière globale, elle participe pour 30 à 40% au PIB des pays africains et fournit 50 à 80% des recettes issues des produits d’exportation. A ce jour, la production agricole en Afrique est assurée principalement par les petits producteurs ou les exploitations familiales. Selon le rapport 2008 de la Banque mondiale, 1,5 milliards de personnes vivent sur de petites exploitations. En Afrique sub-saharienne, 80% des exploitations agricoles sont de type familial et 60% de la population active y travaillent.
Toutefois, malgré le rôle et l’importance des agricultures familiales dans les économies africaines, les paysans, principaux artisans de cette richesse travaillent et vivent toujours dans des conditions difficiles. Les politiques économiques et agricoles internationales et nationales (l’introduction des OGM dans l’agriculture, le contrôle des systèmes semenciers et l’accaparement des terres agricoles, etc.) ne leur sont pas toujours favorables. Aujourd’hui, les terres fertiles, qui servaient à la production pour les marchés locaux de produits alimentaires, sont détournées au profit d’une agriculture industrielle dont les produits destinés au marché mondial.
Les politiques imposées par le FMI et la Banque mondiale à la majorité des pays africains ont créé une dépendance structurelle en importation vivrière, l’idéologie dominante imposant le développement de cultures d’exportation au détriment des productions vivrières. Dans cette lancée, les politiques agricoles des pays africains ont été libéralisées et leurs structures d’appui au monde rural (vulgarisation, fourniture d’intrants, stockage et commercialisation, crédit, stabilisation des prix) ont été progressivement éliminées et ont laissé les petits producteurs sans défense, face aux forces du marché international.
En effet, la plupart des mesures d’accompagnement (réglementaires, structurelles et financières) n’ont pas toujours suivi le désengagement des Etats des secteurs productifs, dont le secteur agricole. Ensuite, l’ouverture des marchés locaux, expose brutalement les paysans africains à une compétition déloyale avec des produits subventionnés du Nord. Par le fait de l’ouverture des marchés, les excédents de production (céréales et produits animaux) des pays industrialisés sont écoulés à bas prix sur le marché africain. Ceci contribue fortement à tuer des initiatives de production domestique des produits identiques ou substituables, dont les coûts de production deviennent plus élevés que le prix des importations subventionnées. A un deuxième niveau, la production de biens alimentaires destinés à l’exportation est rendue peu ou non rentable, étant donné la distorsion des prix mondiaux par les subventions au secteur agricole des pays développés. Le cas du coton africain en est un exemple palpable.
Par ailleurs, à côté des grands complots (les APE, la libéralisation des marchés agricoles prônée par l’OMC, l’UE, etc.) et des différentes offensives pour la colonisation alimentaire de l’Afrique, (OGM, accaparement des terres, etc.), un certain nombre de facteurs communs à l’agriculture familiale expliqueraient en partie les nombreuses situations d’insécurité alimentaire transitoire. En effet, à l’exception de certaines régions où l’intensification agricole s’est imposée, en raison de la raréfaction progressive des terres cultivables, les systèmes productifs des petites exploitations familiales, restent très extensifs et dépendent largement de la pluie. Les superficies cultivées par actif sont faibles (moins d’1 hectare), l’outillage est souvent rudimentaire, même si les agriculteurs font souvent preuve d’ingéniosité et d’une capacité renouvelée d’adaptation. La fumure animale, peu abondante, reste souvent mal valorisée alors que la culture attelée est encore peu développée. Les intrants importés, inaccessibles financièrement, sont le plus souvent réservés aux paysanneries encadrées des projets/programmes rizicoles ou des monocultures d’exportation (banane, coton, café, cacao, ananas).
Justification de notre action : pourquoi intervenir dans ce domaine ?
Inades-Formation considère que l’agriculture familiale est à la base de la sécurité et de la souveraineté alimentaires des populations en Afrique. De ce fait, la solution sine qua non pour éradiquer la faim et l’insécurité alimentaire en Afrique est le soutien (politique, économique, technique et institutionnel) et la promotion de l’agriculture familiale. En améliorant sa productivité, l’agriculture familiale permettra de nourrir les milliers de personnes qui souffrent chaque année de la faim en Afrique subsaharienne.
D’un autre côté, Inades-Formation pense que l’agriculture familiale valorise mieux l’actif humain, crée de l’emploi, ralentit l’exode rural et épuise moins les ressources naturelles lorsqu’elle est bien suivie. Aussi, permet-elle de valoriser et de renforcer le savoir-faire techniques des paysans/paysannes. Enfin, l’agriculture familiale peut développer des technologies alternatives en utilisant les sous produits agricoles et d’élevage comme fertilisants des sols. Ces technologies permettent la pratique d’une agriculture propre et durable.
Les actions d’accompagnement des initiatives en agriculture familiale
Inades-Formation met en œuvre plusieurs programmes/projets d’accompagnement à travers les 10 pays africains dans lesquels il est implanté. Ces programmes/projets ont pour but de stimuler la systématisation, l’expérimentation et la consolidation de la démarche d’appui à la production, à la transformation, à la conservation et à la mise en marché collective des produits agricoles par les petits producteurs/productrices (Entreprenariat collectif agricole). Ainsi, il s’agit d’accompagner les initiatives d’autopromotion des petits producteurs/productrices autour des filières agricoles afin de valoriser leur savoir-faire en agriculture. Pour ce faire, Inades-Formation appuie des organisations socioprofessionnelles (OSP) de paysans/paysannes autour des initiatives d’autopromotion communautaire.
La démarche d’accompagnement des initiatives en agriculture familiale
La démarche, pour mettre en œuvre les programmes/projets d’accompagnement, comporte quatre (4) étapes. Elle commence par une analyse exploratoire pour établir la situation de référence, dégager les forces et les faiblesses, les leviers de développement afin de nous aider à la prise de décision. Après avoir fait une restitution aux paysans/paysannes, ces derniers participent à l’identification d’une série d’actions prioritaires à mettre en œuvre pour résoudre les problèmes relevés par l’analyse exploratoire. Un programme/projet prend forme à partir des actions identifiées. Inades-Formation contribue au suivi et à l’évaluation du programme/projet à travers des séances de renforcement de capacité technique et des missions d’appui/conseil et d’animation d’espaces d’apprentissage mutuel.
Dans la pratique, Inades-Formation utilise l’approche d’accompagnement des dynamiques organisationnelles paysannes (ADOP). Avec cette démarche, Inades-Formation a développé des outils et des procédures permettant aux organisations paysannes de concevoir leurs stratégies de développement et de définir les formes institutionnelles adaptées à leurs conditions et propices à une bonne gouvernance.
Inades-Formation contribue au renforcement des capacités des gestionnaires de ces organisations paysannes, des agents des services techniques étatiques et non étatiques d’appui-conseil et d’autres acteurs de développement.
Inades-Formation participe à des cadres de concertation initié pour la définition des stratégies et politiques nationales pour que soient prises en compte les préoccupations du monde rural africain. C’est aussi la raison pour laquelle, il s’investit dans la réflexion sur la place et le rôle des organisations paysannes dans les processus d’élaboration des politiques de développement. Car ces politiques doivent avoir un impact positif sur la réduction de la pauvreté et le développement économique du milieu rural africain.
A ce jour, deux types d’organisations paysannes sont en expérimentation. Il s’agit :
- des organisations paysannes à caractère syndical dont la mission est d’influencer les politiques de développement afin que les intérêts des producteurs soient pris en compte.
- des organisations paysannes à caractère à la fois économique et social. Les membres se donnent des services communs en mettent à la disposition de leurs organisations leurs ressources financières et leur savoir-faire. Inades-Formation renforce leurs capacités entrepreneuriales de ces micro-entreprises rurales.
Publications d’Inades-Formation sur l’agriculture
Plusieurs séries livrets sont publiées en vue de renforcer les capacités des acteurs de développement et des petits producteurs. Pour les acquérir, se référer aux Bureaux Nationaux dans les pays où Inades-Formation est représenté ou prendre contact avec le Secrétariat général à Abidjan (Côte-d’Ivoire).